
L’art comme outil de reconstruction : Touhami Ennadre, Mohamed Mourabiti et Abdelkébir Rabi’
L’art et la littérature, quand ils jouent véritablement leur rôle, s’assignent pour tâche de contribuer à installer dans le monde la paix durable. Dans ce sens, il s’agira dans ce présent article de fixer notre attention sur les pouvoirs de la création artistique dans la reconstruction du monde, en lui offrant un sens et une vision différents. Or, c’est à un autre départ auquel nous invite justement l’artiste, et, paraît-il, il ne cherche pas à expliquer pourquoi l’homme peut être si violent et sans tolérance, mais son véritable souci est de revoir le début. En bref, c’est à l’instar de ce que disait Anselm Kiefer : « L’artiste croit qu’il y a toujours un autre monde possible ». Entendons-nous bien, l’art invite à une reconstruction du monde qui serait un tremplin vers la paix et la réconciliation. Touhami Ennadre, Mohammed Mourabiti et Abdelkébir Rabi’ nous aident à développer une certaine sensibilité envers ce monde autre, ignoré jusqu’à présent, sinon, du moins, refusé par la « race mortelle » (Valéry).
Force est donc de constater que l’art a ceci de principiel qui consiste dans la quête de la paix et de la réconciliation. Les œuvres artistiques mettent souvent au centre de leurs préoccupations l’acceptation de l’autre. Dans cet article, il sera question d’élucider la thèse suivante : si l’altérité demeure centrale dans le travail de l’artiste, il se trouve que cette altérité a besoin d’art, en ce sens que cette acceptation de l’autre reposerait sur des valeurs artistiques et non sur la morale pensante et moralisatrice.
Primo, l’altérité se présente chez l’artiste en tant que présence nécessaire dans la vie et la survie de soi (identité / altérité), secundo, la paix et la réconciliation se transmettent chez l’artiste par des valeurs artistiques, en particulier, philosophiques et littéraires, en général.
D’abord, les artistes sont souvent attachés à l’idée de l’acceptation de l’autre et au sujet de l’altérité. Cette notion qu’ils abordent d’un point de vue artistique est la preuve qu’ils envisagent d’une autre façon la question de l’autre. Par exemple, ce regard différent porté sur les êtres et les choses leur permet de construire leur propre pensée. A cet effet, un penseur comme Edgar Morin affirme que, dans l’individu, c’est toute l’espèce humaine qui s’y trouve : « ainsi l’individu n’est pas seulement une petite partie de sa société, le tout de sa société est présent en lui dans le langage et la culture. Un individu n’est pas seulement une petite partie de l’espèce humaine. Le tout de l’espèce est présent en lui, par son patrimoine génétique, en chaque cellule et il est présent même dans son esprit qui dépend du fonctionnement du cerveau» (Edgar Morin, Enseigner à vivre, Arles, Actes Sud, 2020, p. 114).
Le lien avec l’autre est une nécessité et il n’y pas lieu de le nier. Ce lien est nécessaire car il est vital, d’ailleurs, personne ne peut s’en passer, dans la mesure où, rien que pour se procurer quelque chose, c’est à l’autre qu’on fait appel, nécessairement. En affirmant « Je est un autre », Rimbaud entend peut-être élargir la dimension humaine à travers la question de la relation entre non seulement le « je », le « tu » et le « il », mais entre tous les éléments constitutifs du Cosmos, entre le micro et le macro. Tout est en relation, la partie ne dépend pas seulement du tout, le tout ne se constitue pas seulement par la partie, mais la partie c’est le tout, le tout, c’est la partie. Peut-être ce lien entre l’homme et le monde prendra-t-il le relais de la dimension humaine de manière à l’élargir en lui accordant une autre signification. Au vrai, il s’avère désormais que l’enseignement doit transmettre une autre façon d’appréhender, par l’entendement et les sens, l’homme et le monde. Autrement dit, il faut enseigner à vivre, et non seulement se contenter de lire et écrire, tant et si bien que le vivre ne se limite pas à la connaissance, mais il se réalise par la connaissance de la connaissance, ajoute E. Morin dans son commentaire.
C’est dire que nous avons besoin d’un autre homme ou d’un homme autre, pour faire référence à Emmanuel Levinas s’imposant à nous ici dès lors qu’il est un des penseurs des plus brillants de l’altérité.
En effet, dans son ouvrage Humanisme de l’autre homme, Levinas soutient l’idée que l’on doit considérer la valeur de l’autre comme une priorité majeure, au sens où l’évoquerait un Dostoïevski, dont la pensée de Levinas s’inspire amplement.
Ensuite, tout est d’accord que la guerre ne sert à rien. C’est l’invention des arrivistes fous d’argent, c’est le Mal Absolu, qui fait l’éloge de la mort contre la vie. Ses conséquences sont très graves car elle empêche les gens de vivre la vie que la Nature leur a offerte. Le destin de l’homme se joue au niveau de cette dialectique : la Nature (le Cosmos) offre la vie, l’homme, par la guerre et la violence, l’ôte. Finalement, à y réfléchir, faire la guerre ou la laisser faire est la chose la plus ignoble qui soit, car elle permet à la mort de vaincre la vie. Comment alors en finir avec cette faucheuse fatale, ou, en partie du moins, comment la diminuer ? Comme nous l’avons souligné ci-dessus, ce n’est pas par un discours moraliste qu’on pourrait la combattre, mais par un discours inspiré par l’art.
Il faudra, en ce sens, être conscient de son appartenance en tant qu’individu à l’espèce humaine. L’homme est dans le monde, c’est-à-dire dans la société et dans l’autre : « Je est un autre », pour rappeler Rimbaud. En d’autres termes, Rimbaud a compris que l’individu a besoin d’une éthique du genre humain pour éviter le pire.
Il devient urgent de revoir l’enseignement et le concevoir dans le sens de l’unité, et non au sens de la séparation. Par exemple, la manière dont on enseigne la science reste réductrice quant à la question humaine. Les choses ne sont pas si simples que cela semble en avoir l’air, elles sont, au contraire, complexes, et c’est cette complexité qu’il faut interroger de manière à s’y adapter. Ainsi un philosophe comme Maurice Merleau-Ponty récuse-t-il la science et ses limites, en tenant plutôt à mettre l’art au centre de ses réflexions philosophiques: « Quelle est l’attitude du savant face au monde ? Celle de l’ingéniosité, de l’habileté. Il s’agit toujours pour lui de manipuler les choses, de monter des dispositifs efficaces, d’inviter la nature à répondre à ses questions. Galilée l’a résumé d’un mot : l’essayeur. Homme de l’artifice, le savant est un activiste » (Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964).
En revanche, l’artiste est privilégié : « Aussi évacue-t-il ce qui fait l’opacité des choses, ce que Galilée appelait les qualités : simple résidu pour lui, c’est pourtant le tissu même de notre présence au monde, c’est également ce qui hante l’artiste. Car l’artiste n’est pas d’abord celui qui s’exile du monde, celui qui se réfugie dans les palais abrités de l’imaginaire. Qu’au contraire l’imaginaire soit comme la doublure du réel, l’invisible l’envers charnel du visible, et surgit la puissance de l’art : pouvoir de révélation de ce qui se dérobe à nous sous la proximité de la possession, pouvoir de restitution d’une vision sur les choses et nous-mêmes. L’artiste ne quitte pas les apparences, il veut rendre leur densité […]. Si pour le savant le monde doit être disponible, grâce à l’artiste il devient habitable» (Ibid.).
Suivant le phénoménologue, que rejoint dans une large mesure le concept de complexité d’Edgar Morin, l’artiste a le mérite d’aborder les choses en tant qu’objets complexes. L’artiste invite à une immersion dans le monde, à aboutir à une saisie globale de l’objet dans sa totalité, c’est-à-dire à chercher ce qu’il a de relationnel.
Il s’avère clairement que l’enseignement, tel qu’il est pratiqué, doit être remis en cause. C’est donc tout le système scolaire qu’il faut changer. L’école doit mettre au centre de ses réflexions désormais la dimension humaine, qu’il faut transmettre en exploitant la transmission artistique, ainsi aurons-nous une école qui tiendrait compte de la part essentielle et basique qui nous rassemble, à savoir tout simplement notre devoir envers l’autre.
Par là, nous revenons évidemment à l’école, celle-ci, soumise toujours au pouvoir, ne pouvant se libérer de ses mécanismes, souvent basés sur les conflits, les rapports de force et la médiocrité. Il devient de plus en plus manifeste actuellement que l’école ne joue plus son rôle, celui de produire des individus en mesure de critiquer ce qu’on leur fait avaler à travers les médias dévastatrices. Nos enfants sont exploités de la manière la plus absurde à cet âge où on est très sensible. Comment attendre d’un enfant à ce qu’il soit critique, alors qu’il est encore à une étape de novice en apprentissage ? C’est donc tout le Système qu’il faut revoir en espérant un jour réaliser ce que Marguerite Duras affirmait avec détermination :
« Je crois que si on ne fait pas ce pas, intérieur, si l’homme ne change pas dans sa solitude, rien n’est possible, toutes les révolutions seront truquées. Ça, je le crois profondément. Je suis pour qu’on ferme toutes les facultés, toutes les universités, toutes les écoles. Profondément. Qu’on recommence tout. Le départ à zéro. Je suis pour qu’on oublie l’Histoire […] Qu’il n’y ait plus aucune mémoire de ce qui a été vécu, c’est-à-dire de l’intolérable, sur tous les fronts, sur tous les points. Tout casser » (France Culture, Marguerite Duras, https://www.youtube.com/watch?v=KBum9zj-9p8, 1969).
Clairement, Duras sait que l’oubli est nécessaire pour pouvoir construire une nouvelle mémoire qui soit plus tolérable, c’est-à-dire plus humaniste. C’est là une solution politique très utile actuellement pouvant permettre de sortir de la guerre. La question de la mémoire à laquelle on est très attachée doit être construite sur de bons soubassements, contrairement à une mémoire malheureuse reposant sur la vindicte. Duras sait bien que c’est par l’enseignement que cela pourrait se résoudre, car c’est à l’école qu’on forme les esprits.
Etant solidarité et responsabilité et ne se définissant pas par des leçons de morale, l’éthique n’est pas la morale, car elle n’est pas obligation. Paul Ricœur nous l’apprend dans Soi-même comme un autre. L’éthique se distingue de la morale par ce qu’elle est un choix, contrairement à la morale qui est obligation. Car, comme tout un chacun peut le savoir, il suffit d’imposer quoi que ce soit à l’autre pour qu’il le refuse déjà.
Par conséquent, il sera question d’interroger les valeurs artistiques susceptibles de sauver l’homme de la violence et de la guerre, à savoir : l’éloge de la vie par l’art et la poésie. Le retour à ces valeurs paraît salvateur actuellement.
L’objectif principal étant de montrer que l’art photographique et l’art pictural sont deux moyens concrets qui permettent à l’homme d’être dans l’action et de combattre la guerre.
Suivant une première tentative de lire la photo de Touhami Ennadre, nous pouvons la diviser tout d’abord selon deux plans : le plan de l’expression et le plan de contenu.

Fig. 1.sans titre
Deux couleurs prédominent dans cette photo, le noir et le blanc. A la couleur, significative bien sûr, s’ajoute la forme du visage, apparemment celui d’un nègre, et au-dessus, apparaissent des traits et de l’écriture. Et en plus, il y a le numéro 331.
Tentant de déchiffrer le sens des mots, nous découvrons dès le premier regard qu’il y a au centre de cette photo “l’humain”, en ce que ce dernier est le plus concerné. En témoigne par exemple, « Mann » : homme, « Kleinkind » : petit enfant.
Ajoutons de même que l’image que nous renvoie la photo prise par Ennadre serait celle d’un mur sur lequel on laisse des traces.
Ce qu’on peut en savoir, c’est que cela a rapport avec l’allemand et donc avec l’Allemagne, puisque la langue utilisée dans la photo est l’allemand. Sans se précipiter et avancer dans une interprétation fortuite, il faut dire que le contenu nécessite le passage par une documentation importante. Dans ce cas, heureusement pour nous, c’est le photographe lui-même qui vient à notre aide. Voici ce qu’il dit :
« Je fais bientôt face à une montagne de bagages laissées en souffrance. Sur l’avant des valises, les initiales de ces hommes, femmes, enfants, vieillards, raflés, exterminés, figurent en caractères épais tels des hématomes, les seules traces de ces gazés qui, bien qu’assassinés, sont des stigmates omniprésents. Y compris derrière les numéros incrustés dans la chair des survivants et, pour toujours, dans ma propre mémoire» (Maison de la photographie, touhamiennadre.wordpress.com, 27 janvier 2025).
On le voit, le photographe avait été photographier l’endroit où les juifs ont été gazés jusqu’au dernier. L’histoire nous interpelle ici. Il s’agit des camps de concentrations d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d’extermination nazi du troisième Reich.
Et le numéro 331 se comprend désormais, grâce au retour à l’histoire. Les prisonniers sont réduits au numéro, pour leur ôter la part de l’humain qui leur restait. La chosification et la réification de l’humain se cristallisent une fois réduits à un chiffre.
D’où l’intérêt de la photo qui ne se limite pas à sa fonction esthétique, mais qui se pourvoit d’une valeur historique. En effet, on peut rapporter l’histoire (des juifs en particulier) et l’Histoire (humaine en général) en moyennant la photo. Et, à notre grand bonheur, la photo n’est pas le livre et il paraît qu’elle est plus universelle car elle peut être, émotionnellement, universelle. Lettré et illettré confondus ne peuvent pas échapper à la mémoire, celle-ci provoque la question de l’éthique, commune à nous tous. Le photographe lui-même est interpellé par deux mémoires dans le fond, celle des Juifs qui ont vécu le drame et celle qui l’agace après avoir visité le camp de concentration. Pour le comprendre, il suffit de penser aux reportages consacrés à la guerre, qui nous apprennent entre autres que les soldats n’arrivent pas à parler de la guerre à laquelle ils ont participé. Autrement dit, face à l’horreur intenable, il n’y a plus rien à dire : la langue se tait. Dans cet ordre d’idées, nous vient à l’esprit Antonio Lobo Antunes qui écrit dans Le cul de Judas :
« […] nous descendions vers les Terres de la Fin du Monde, à deux mille kilomètres de Luanda ; janvier se terminait, il pleuvait, et nous allions mourir, nous allions mourir et il pleuvait, il pleuvait, et assis dans la cabine de la camionnette, à côté du chauffeur, le béret sur les yeux, la vibration d’une cigarette infinie à la main, j’ai commencé mon douloureux apprentissage de l’agonie» (Antonio Lobo Antunes, Le cul de Judas, Métailié, Paris, 1983, p. 45).
Or, comme on peut s’en apercevoir derechef, le passé n’est pas dissocié du présent ni de l’avenir. L’Histoire se répète, mais sous des formes apparemment changeantes, bien que ce soit en réalité la même, tant que c’est de la condition humaine qu’il s’agit en permanence. C’est cela qu’explique Ennadre lorsqu’il compare Auschwitz à Gaza :
« L’air me cerne des complaintes emmêlées des victimes et la cacophonie de leurs sanglots n’aura de cesse d’habiter ma tête jusqu’à ce jour. Je tremble devant l’image – tournée après coup : la sidération des troupes retombée – de ces êtres rachitiques ni morts ni vivants qui n’avaient plus que la peau sur les os, dont les regards, au-delà de la souffrance et de l’espoir, n’osent demander grâce aux soldats russes venus les libérer. Comment ne pas retrouver la même tragédie indicible à Gaza, dans les yeux de cette mère qui ramasse les miettes éparpillées de son enfant carbonisé, pour les mettre dans un sac poubelle, qu’une bombe israélienne vient de déchiqueter ? » (Maison de la photographie, touhamiennadre.wordpress.com, op.cit.).
A la mémoire des Juifs s’ajoute celle des Palestiniens, tous victimes de la guerre, c’est-à-dire de la violence de l’homme, car la guerre n’aurait jamais, bien entendu, existé sans l’homme qui l’a faite. Ainsi le chromatique utilisé dans la photo nous interpelle-t-il, ainsi le blanc-noir se pourvoit-il d’une valeur esthético-éthique. Le mur noir sur lequel est tracée une écriture blanche n’est pas sans en dire long sur les morts, qui, ayant perdu tout espoir, ont laissé tout de même des traces, témoignant de leur survie humaine, qui resteraient dans les mémoires. On est en effet au cœur de la mémoire. La photo est ici mémoire. Ce sont des photos-mémoires. Cet espoir que l’être humain cherche à garder même dans les moments les plus durs est expliqué par Victor Hugo dans son roman à thèse : Le Dernier Jour d’un condamné. Le condamné à mort décide d’écrire son mémoire mnémonique en souhaitant que d’autres s’en souviendront un jour :« Que ce que j’écris ici puisse être un jour utile à d’autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l’agonie à laquelle je suis condamné» (Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné, Casablanca, Librairie Al-Ouma, 2008, p. 19).
En outre, le blanc-noir, représentatif du Bien et du Mal, est continuellement en guerre. Par la résistance et l’action, passant par l’art et le bon savoir, l’espoir de trouver un monde meilleur serait assuré.
Comme nous nous en avisons plus clairement actuellement, la guerre n’émane pas principalement des raisons de différences ethniques, de race ou de religion, mais du refus de l’autre. C’est pourquoi, la plupart des tragédies humaines reposent sur le déni. Pour réagir au drame des Gazaouis, Ennadre écrit : « Comme une évidence insupportable, m’apparaît soudain la fraternité entre le Palestinien de Gaza et le Juif de l’Holocauste, victimes déracinés par le même déni d’existence de l’autre» (Maison de la photographie, touhamiennadre.wordpress.com, op.cit.).
D’où l’intérêt incontournable des arts, notamment visuels. A regarder cette fois-ci la peinture de Mohamed Mourabiti, on s’aperçoit que ce qui le préoccupe dans le premier abord, c’est la question du sacré. En effet, les titres indiqués par l’artiste nous rapprocheraient du sens véritable de sa peinture, dans la mesure où les mots « abstrait » et « marabout » renvoient déjà au monde où il y aurait quelque chose d’invisible inhérent au sacré, s’élevant au-delà du visible, ce dernier étant une apparence, empêcherait l’homme de voir l’invisible, c’est-à-dire le sacré. Certes, il se peut qu’avec de la peinture il soit difficile de saisir ce qu’elle transmet, mais il va de soi que c’est là où l’enseignement demeure basique. Une éducation artistique invoque notre action actuellement et ce de la manière la plus urgente ; elle initierait nos enfants à l’art, car ce dernier, contrairement à ce qu’on croit, s’apprend.
Dans le premier tableau de Mourabiti (fig. 2), « Abstrait Noir et Blanc », il y a la présence des deux couleurs fondamentales, le noir et blanc, qui sont les mêmes couleurs dont use également Ennadre. Ces deux couleurs, en plus de leur capacité à donner plus de lumière, seraient des couleurs qui auraient des connotations au sacré. La nuit et le jour, le Paradis et l’Enfer, les Lumières et les Ténèbres, la vie et la mort.
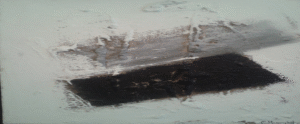
Fig. 2 : Abstrait Noir et Blanc de Mourabiti
Dans une tentative d’interprétations, les deux formes tracées sur cette espèce de mur, ou sur une terrasse, sont dessinées sous forme de tapis, outil dont on se sert pour faire la prière. Dans le second tableau de Mourabiti (fig. 3), on voit qu’il s’agit d’un marabout, ainsi que l’indique le titre de la toile. Il a une forme verticale qui souligne également le rapport au divin :
« Le côté sur lequel je travaille, dit M. Mourabiti, ce sont les saints, et c’est ce qu’on appelle dans l’Afrique profonde : les marabouts. Ça, c’est un symbole qui représente ce côté sacré, que tous les Africains connaissent qui ont ce rituel d’honorer un saint. La signification que je donne du marabout, c’est ce qui ouvre une porte vers l’autre, c’est-à-dire un marabout, chrétien, juif ou musulman, ce qui nous intéresse, c’est la sainteté du saint, c’est-à-dire comment il est humain» (Mohamed Mourabiti, Instagram).

Fig. 3. Marabout de Mourabiti
On le constate, la question est relative à l’éthique. Ce n’est pas le symbole en tant que tel qui compte, mais c’est ce qu’il cache comme signification. D’autant que le peintre parle de sacralité comme ayant le sens d’humain. La sainteté des saints consiste en ce qu’elle est pour l’amour de l’humanité, et cet amour ou passion sont transmis ici non par des leçons de morale, mais par l’art, en ce sens que le marabout s’adresse à l’humain de l’homme, et non à sa religion, d’où il résulte une universalité assurée de la transmission artistique. Cette universalité trouve toute sa signification dans l’altérité.
Or donc, l’universalité se réalise par la simplicité et l’humilité. Transmettre d’une manière simple et humble rend la transmission plus universelle du moment qu’elle peut toucher l’humain que nous avons en nous.
On peut de même penser que l’art atteint toute son importance quand on le vit dans la vie quotidienne, ne se limitant pas au musée et aux espaces artistiques. On le comprend mieux quand on écoute l’artiste dire à propos de Jamaa Elfna :
« Il y a de la magie à Jamma Elfna, une scène où on trouve toutes les expressions, quand tu viens, tu vois la ville, les gens et les artistes qui animent tout ça, mais pour moi c’est une école, j’ai vécu toute mon enfance à Marrakech, mais je crois que c’est un patrimoine qui donne vraiment toute l’énergie et toute la force pour m’exprimer, pour me lancer et continuer mon travail. J’ai décidé d’installer mon atelier ici à Tahnaout pour créer un lieu qui peut être de partage, qui peut être simple, avec des moyens simples et avec un esprit simple» (Mohamed Mourabiti, page Instagram).
Soulignons enfin que l’art, quand il est véritable, demeure l’antidote de la morale moralisatrice, celle-ci étant le propre du texte religieux, en grande partie. La religion, au-delà de son apport important quand elle est interprétée positivement, demeure à notre sens moins pratique sur le sujet de la vie et de la mort, et ce pour une raison centrale, à savoir la manière dont elle les aborde. Dans les textes religieux, c’est la question de la mort qui est mise au centre de la rhétorique, alors que l’essentiel dans l’art demeure la vie et l’éloge de la vie. Sans pour autant négliger la question de la mort, l’art fait l’éloge de la vie, compte tenu de ceci que nous ne pouvons vivre qu’une seule vie. C’est pourquoi cette conscience géniale pour la nécessité de vivre pleinement sa vie, dont l’artiste fait un principe, lui permet de privilégier la vie au détriment de la mort, et, par conséquent, enseigner à s’accrocher à la vie coûte que coûte. Aimer tellement la vie sans refuser de mourir. Telle fut l’idée que partage avec nous l’artiste à travers son œuvre. Le sacré en question trouve ses racines à l’intérieur de la vie, le sacré de la vie.
Abdelkébir Rabia’, fidèle à la mémoire, consacre sa dernière exposition à son village natal, Bouelmane, situé au sud du Moyen Atlas. Moyennant le fusain, une matière simple, le peintre a voulu peindre les montagnes de ce village qu’il connaissait de plus près. Ce qu’on voit dans le tableau, ce sont des réminiscences d’un passé lointain, gardé par la mémoire. La mémoire incarnant ici à la fois le passé, le présent et le futur.
Dans son exposition récente, le peintre Rabia’ met en scène la forêt avec ses grands arbres. Or, comme le dit Abdelkébir Khatibi, qui a consacré au peintre un texte intitulé Vœu de silence, le silence est ici langage, car la forêt, avec ses arbres, s’exprime. Est-ce qu’on sait écouter ce que nous disent les arbres?
Peut-être l’intention du peintre réside-t-elle dans sa volonté à vouloir entendre la voix du silence. Il faudrait apprendre à voir et à écouter dans le silence, car le silence est assourdissant, c’est-à-dire une parole silencieuse.
D’où il s’ensuit que le silence est poésie : « Le poète est seul devant la puissance infinie du silence, garant et abîme de son chant » (A. Khattibi, Vœu de silence, Paris, Al Manar, 2000). Le silence est l’expérience singulière du poète, l’homme de la solitude. Le poète réclame le silence car il sait par-dessus tout qu’il est un secret. Son langage à lui est un langage du silence. Il fonctionne par le signe. « C’est un langage au-delà de tout langage. Ainsi le signe cache-t-il l’énigme de toute expressivité » (Ibid.). Le silence, cette science du poète et du peintre, celle que Rimbaud s’octroiera au détriment de l’écriture.

Fig. 4. Abdelkébir Rabi’ en 3D, février 7, 2025.
De même, le peintre fait ici l’éloge de la nature au sens sartrien, ce dernier ayant senti que la nature parle :
« Alors le jardin m’a souri. Je me suis appuyé sur la grille et j’ai longtemps regardé. Le sourire des arbres, du massif de laurier, ça voulait dire quelque chose ; c’était ça le véritable secret de l’existence. (…) Etait-ce à moi qu’il s’adressait ? Je sentais avec ennui que je n’avais aucun moyen de comprendre. Aucun moyen. Pourtant c’était là, dans l’attente, ça ressemblait à un regard. C’était là, sur le tronc du marronnier…c’était le marronnier» (J.-P. Sartre, La Nausée, Paris, Gallimard, 1938, p. 190.).
C’est dire que la nature lance un appel, si l’on apprend à l’écouter, à l’instar de l’artiste, à ce rapport à l’autre, à entendre l’autre ici et maintenant non seulement en tant que quelqu’un mais aussi comme quelque chose.
Dans cet ordre d’idées, on peut se reporter également à Noces à Tipasa, d’Albert Camus, qui montre que l’homme appartient à la nature et que la nature lui appartient. Nous ne pouvons pas échapper à la rencontre avec la nature, il suffit d’accepter d’y vivre pleinement, ensemble.
Un point n’est pas anodin, c’est la dimension du sensible. La nature impose le silence, non l’intelligible. Au sens où en parle Merleau-Ponty, il s’agit de ressentir plus que de chercher à comprendre. La nature est le domaine de l’émotion, de l’ébahissement et de l’étonnement. En d’autres termes, la nature est une vie philosophique.
Or, le lecteur se demandera sans doute en quoi consiste le rapport à la guerre. Le lien consiste exactement dans cette idée que le retour à la nature, à sa méditation, à son amour, nous aidera à être plus sensibles aux choses et à la vie, comme y font droit Sartre et Camus.
L’enseignement doit aujourd’hui, plus que jamais, s’inspirer de ces humanistes et faire en sorte de le diffuser partout, depuis le primaire. Pourquoi ne pas enseigner la philosophie aux enfants ? Pourquoi ne pas leur apprendre cette responsabilité envers autrui, au sens où l’évoque Levinas ?
Il faut insister sur le fait que l’enfant soit le père de l’homme, car c’est à cet âge qu’on peut construire une personnalité qui aime son prochain et l’homme de manière générale. Par conséquent, l’amour de l’autre et la responsabilité pour autrui permettront dans l’avenir un homme autre, c’est-à-dire celui capable de se sentir plus responsable que les autres, pour ainsi reprendre la formule de Dostoïevski.
