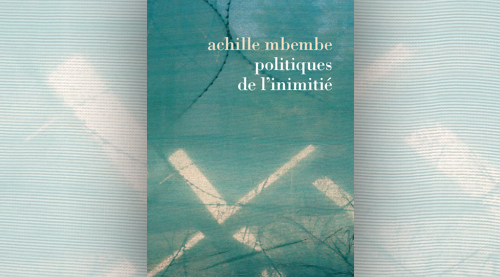
« Politiques de l’inimitié » d’Achille Mbembe : autopsie d’un monde en crise
Publié en 2016, aux éditions la Découverte, Politiques de l’inimitié du philosophe camerounais, Achille Mbembe, est un essai qui explore les problématiques du monde, en ce début du XXIème siècle. L’ouvrage se veut une critique du temps (présent), marqué par le militarisme et le marché. En s’appuyant sur une grille de lecture pluridisciplinaire, l’auteur a procédé à une analyse approfondie des nouveaux rapports qui se dessinent entre les nations, et qui donnent à voir le monde comme un corps malade.
S’il y a un mot, qui s’apparente à un paradigme, et qui régit les relations internationales, au sortir du XXème siècle, c’est bien « l’inimitié ». Désormais, « le besoin d’ennemi » sous-tend les politiques étrangères de bien des nations. Telle est la thèse soutenue par l’auteur, qui s’appuie dans sa réflexion sur des rapports de plus en plus tendus entre les pays du monde.
Puisant ses outils théoriques dans l’Histoire et la psychiatrie, Mbembe ne se contente pas de décrire des faits, mais il remonte très loin, en essayant de comprendre les raisons d’une telle « névrose politique ». En ce sens, il explore les différents âges de la démocratie occidentale. Cette digression permet au philosophe de mieux cerner les premières « inimitiés », notamment l’esclavage et le racisme, d’Empires devenus par la suite des démocraties néo-libérales. Le chapitre intitulé La pharmacie de Fanon est une généalogie de la relation d’inimitié dans les sociétés démocratiques, qui, selon l’auteur, se sont accomodéés de l’esclavagisme et du régime colonial. Ces derniers, aux yeux de l’historien, n’ont jamais été des corps étrangers à la démocratie « A la limite, il n’est donc de démocratie libérale que par cet appoint du servile et du racial, du colonial et de l’impérial […] »[1] .
Le retour des guerres, qui sont en corrélation avec le marché (le capital), selon le politologue, est l’un des signes symptomatiques d’un monde vivant une dépression politique. Cette « appétence » pour la guerre est un pharmakon, qui sert à la fois de remède et de poison «[…] la transformation de la guerre en pharmakon de notre époque a, en retour, libéré des passions funestes qui, petit à petit, poussent nos sociétés à sortir de la démocratie et à se transformer en société de l’inimitié, comme ce fut le cas sous la colonisation »[2].
Dans les différentes réflexions autour desquelles le livre s’articule, Mbembe convoque Frantz Fanon. La grille fanonienne lui permet de se pencher sur un autre mal qui gangrène le monde, qu’est le racisme. A partir de ce dernier, l’historien tente d’explorer les violences feutrées dans les démocraties modernes, qui connaissent le retour en surface de ce qu’il appelle « devoir de la race »[3].
Désormais, au sortir de ce XXème siècle, le temps est au repli, engendré par la peur de l’autre. Une posture qui explique une certaine passion pour le passé, refuge d’un sujet en crise, qui se manifeste à travers un enthousiasme effréné pour les origines « L’enthousiasme pour les origines se nourrit d’un affect de la peur provoquée par la rencontre-pas toujours matérielle, un fait toujours fantasmatique et en général traumatique- avec autrui »[4]. Pour appuyer ses arguments, l’auteur donne comme exemple les frontières. Le philosophe voit dans les lignes tracées entre les nations un symbole de séparation « Les frontières ne sont plus des lieux que l’on franchit, mais des lignes qui séparent […] »[5].
1-L’enthousiasme pour les origines et la fin des temps
L’un des paradoxes que vit notre monde en ce début du XXème siècle, marqué par le développement technologique et la logique des algorithmes est cet enthousiasme pour les origines et la fin des temps, qui touche et la postcolonie et les sociétés néo-libérales.
En postcolonie, cet engouement, selon Mbembe, pour la fin du monde, s’énonce dans le langage du religieux. Tombés dans les rets d’un discours mytho-religieux, ces « damnés de la foi »[6], invoquent « l’apocalypse » tout en affichant un enthousiasme pour le passé « En postcolonie, où sévit une forme particulière du pouvoir dont le propre est de lier dominants et assujettis dans un même faisceau du désir, l’enthousiasme pour la fin s’exprime souvent dans le langage du religieux […] »[7].
Ce « raisonnement » mytho-religieux dans les démocraties libérales, se manifeste à travers « de grands ensembles mythologiques »[8], qui justifient une logique guerrière. Les attentats terroristes sont souvent des occasions pour exacerber l’affectivité et décréter des deuils sur commande. Ainsi, est titillée la fibre nationaliste, qui se débouche par une « fabrication de l’ennemi ».
2-L’en-commun à la place de l’universel
Selon Mbembe, la démocratie telle qu’elle a été conçue et vécue par les sociétés occidentales, c’est-à-dire une « juxtaposition de singularités »[9], est aujourd’hui en crise ; de ce fait, il y a nécessité de repenser le fait démocratique. Cela ne peut se faire qu’à travers un questionnement des concepts qui ont servi jusqu’à présent comme référents. Autrement dit, il faut interroger un langage saturé qui ne répond plus aux problématiques de l’homme du XXIème siècle. Parmi ces concepts que l’historien propose de remplacer, il y a l’universel. A ce dernier, l’essayiste préfère « l’en-commun ». En ce sens, il écrit « (…) la démocratie à venir se construira sur une nette distinction entre ‘ l’universel ’ et ‘l’en-commun’. L’universel implique l’inclusion à quelque chose ou quelque entité déjà constitué. L’en-commun présuppose un rapport de coappartenance et de partage »[10].
En définitive, malgré une écriture jargonneuse, (profusion de concepts), qui pourrait rebuter le lecteur, l’utilité de cet essai consiste dans le fait qu’il propose une lecture pluridisciplinaire sur des problématiques complexes du temps présent. L’auteur ne se contente pas de dresser un tableau noir sur un monde rongé par des fléaux néfastes, qui sont le racisme et « les nationalismes ataviques ». L’essayiste appelle à une politique du vivre « en commun », qui se débouchera sur un nouvel humanisme. Aux pulsions identitaires, il suggère l’éthique du passant. Une éthique seule à même de prémunir le sujet contre la folie de la race et l’aveuglement pour les origines.
Achille Mbembe, Politiques d’inimitié, la Découverte, Paris, 2016
[1] Achille Mbembe, Politiques d’inimitié, la Découverte, Paris, 2016, p.105.
[2] Ibid., p .11.
[3] Ibid., p.15.
[4]Ibid., p.52.
[5] Ibid.,p.43 .
[6] Ibid.,p.83.
[7] Ibid.,p .52.
[8] Ibid.,p.85.
[9] Ibid .,p.67.
[10] Ibid.
