
« L’honneur et la liberté ont besoin d’être redéfinis en Algérie », Myassa Messaouadi, romancière
Dans son dernier roman, Honneur à crédit, Myassa Messaoudi revisite le massacre des douze enseignantes survenu à Sidi-Bel-Abbès pendant la décennie noire. Un traumatisme personnel qui l’amène à questionner la place des femmes dans la société algérienne postcoloniale et la notion d’honneur. Entre mémoire occultée et combat pour la liberté, elle dénonce l’héritage de la concorde civile qui a selon elle renforcé l’emprise idéologique de l’islamisme. À travers le parcours de Lamia, son personnage principal contrainte à l’exil, elle explore les ruptures nécessaires pour conquérir sa propre liberté. Un récit qui interroge autant l’Algérie d’aujourd’hui que les conditions d’une véritable émancipation.
Votre roman parle d’un massacre qui a eu lieu à Sidi-Bel-Abbès, dans l’ouest algérien, pendant la décennie noire. Pourquoi revisiter ce massacre ? Qu’est-ce qu’il représente pour vous ?
Ce massacre représente un traumatisme, avant tout au niveau personnel. Il a eu lieu dans ma région. J’ai fait partie de cette génération de femmes diplômées qui auraient pu finir comme les enseignantes assassinées. Ma propre sœur enseignait dans les mêmes conditions que les défuntes. Elle faisait des dizaines de kilomètres par jour pour rejoindre son travail. La route était une épreuve traumatique quotidienne pendant la décennie noire, avec son lot de cadavres et de faux barrages. Mais ma sœur comme tant d’autres professeures n’ont jamais renoncé à leur mission. Ces femmes, nombreuses dans le corps enseignant, ont participé, au péril de leurs vies, à sauver l’école républicaine. Pourtant on l’oublie !
Le terrorisme islamiste a visé violemment les femmes. Les assassinant, les séquestrant et les privant de leurs propres corps dont il affectionnait l’appropriation et le martyre. C’était aussi une forme de guerre des sexes effroyable. Menée par des misogynes lâches armés jusqu’aux dents contre des femmes munies uniquement de leurs connaissances et de la volonté de les transmettre.
Aujourd’hui, le martyre républicain des douze enseignantes est rarement mentionné. La triste date de leur assassinat n’est pas commémorée au niveau national. C’est injuste envers elles, et envers toutes les femmes algériennes qui ont aidé à sauver le pays d’une talibanisation certaine. C’est aussi criminel envers la nation. Car tout cela relève de la mémoire, de notre histoire, des leçons qu’un pays doit tirer de ses propres expériences, même tragiques, pour se reconstruire et éviter les répétitions.
La concorde civile, au-delà de l’impunité accordée aux assassins, a malheureusement agi comme un anesthésiant national à une plaie qui continue de s’infecter ; nous privant d’un examen de mémoire salutaire, et accordant à l’intégrisme une deuxième chance pour sévir à nouveau. Sous d’autres formes bien entendu.
En quoi replonger dans un moment traumatique est-il intéressant pour la romancière que vous êtes ?
La romancière que je suis est allée au-delà du traumatisme, pour traiter de la question de fond, qui est la place des femmes dans la société algérienne postcoloniale. Sommes-nous réellement respectées dans notre pays ? Pourquoi tente-t-on continuellement de minorer notre statut et notre rôle dans la société ? Pourquoi a-t-il fallu légiférer de manière inique sur notre condition comme si nous étions des délinquantes en sursis ? Pourquoi au pays des reines berbères, insulte-t-on notre sexe ?
L’honneur chez nous est mal placé parce qu’on en a perdu les vrais codes. Au lieu de punir les fautifs, on blâme la victime. Au lieu de sécuriser les lieux publics, on restreint la libre circulation de la moitié de la population que sont les femmes. Au lieu de pallier les problèmes de l’ennui résultant des interdits religieux régressifs et des frustrations sexuelles, on oblige les femmes au voilement. L’honneur est au centre du roman. Il est questionné à chaque page, parce qu’on a besoin de le redéfinir. Il ne saurait se perpétuer en outil de mauvais traitements juridiques et sociaux infligés aux Algériennes, voire en prétexte aux assassinats crapuleux.
Un haut responsable algérien ayant participé à la lutte antiterroriste en Algérie a dit que l’islamisme a été vaincu militairement mais il a triomphé politiquement et idéologiquement. Partagez-vous cet avis ?
Non seulement l’islamisme, en tant qu’idéologie, a prospéré, mais il a aussi démontré qu’il est le meilleur allié de la corruption et de la dégradation des mœurs et de l’environnement. Observez ce que sont devenues nos fêtes religieuses, le ramadan. Ce ne sont plus que des lieux de prédations commerciales impitoyables. De la paresse institutionnalisée. L’école se « madrassinise » crescendo. L’incivilité se propage de manière endémique. L’esprit d’inquisition habite les mentalités, et le complotisme prospère. L’islamisme annule la faculté de s’interroger, de se penser. Il oppose à toutes ses inaptitudes de gestion et de propositions, Dieu comme un paravent. Quand il ne met pas carrément la souveraineté et l’unité du pays en danger parce qu’au fond, il ne reconnaît pas l’autorité de l’État jugée profane et déviante, mais celle des cheikhs et des muftis qui légifèrent en se référant à des pôles religieux étrangers.
Nous n’avons pas encore acquis l’indépendance confessionnelle, or elle s’avère aussi importante que celle du territoire. L’islam algérien est marginalisé au profit d’une idéologie usurpatrice de son essence et de son identité. C’est l’outil de soumission de ceux qui ne produisent pas de technologies conquérantes, mais compensent pour dominer avec une foi qui agit comme un « reset » sur la culture et l’histoire du pays. Tout cela piège les débats cruciaux tels que la diversité des langues, le statut des femmes, le système éducatif, l’identité, le modèle socio-économique et la démocratie.
On est en droit aujourd’hui de questionner le bilan de la concorde civile. De procéder aux corrections nécessaires. La concorde civile ne jouit d’aucune sacralité. Et il est évident, qu’en plus d’avoir renforcé le délitement général, elle n’a profité qu’aux islamistes et à la gouvernance pillarde qui l’a initiée et que le peuple a déposée lors du hirak.
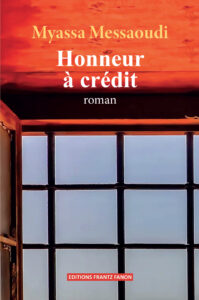
Votre personnage Lamia va quitter l’Algérie en quête de liberté. L’Algérien est-il condamné à toujours aller chercher la liberté ailleurs que chez lui ? Qu’est-ce que ce sentiment de ne pas être à sa place dans son propre pays vous inspire ?
Lamia, le personnage principal de mon livre, quitte son pays dans des circonstances dramatiques. Elle essaie d’abord de sauver sa peau. Ayant survécu miraculeusement à deux barrages meurtriers, elle décide de prendre sa vie en main et de fuir. Le livre est une suite de ruptures. D’abord celle avec sa propre famille, puis celle avec le pays, devenu un lieu dangereux pour elle.
D’autres ruptures suivront. Le pays d’accueil qu’est la France n’est pas tout à fait ce qu’elle imaginait. Rappelons qu’il s’agit des années quatre-vingt-dix, et que l’immigration algérienne d’alors était fortement éduquée. Elle n’a rien à voir avec les vagues précédentes qui étaient principalement ouvrières.
Elle pose donc un autre regard sur le pays d’accueil. Elle observe des évolutions sociales, que les Français plongés dans le formol de leur passé impérial ne voyaient pas. Rappelons que l’islamisme en Europe s’est propagé avec l’avènement des chaînes d’information en continu des pays du Golfe. Les médias, tout comme aujourd’hui, sont de bons vecteurs de fascisme.
Lamia finit par mettre la conquête de sa propre liberté avant toute considération. Cela passe évidemment par le corps et la révision de la notion d’honneur qu’on lui a inculquée. Gagner sa liberté suppose des sacrifices et justement un sens fort de la responsabilité.
Dans le roman, votre personnage a réussi à dépasser sa condition de citoyenne de seconde zone et a pu s’accomplir. Mais cela s’est fait individuellement et très loin de son pays et des siens. Peut-on, dans ces conditions, parler de libération ?
Évidemment, liberté bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut être libre collectivement sans l’être individuellement. Et être libre tout seul est bien moins marrant, c’est pour cela qu’on finit toujours par lutter pour l’être ensemble. Je suis sûre qu’il y a beaucoup de gens libres en Algérie de manière individuelle, mais secrètement. Il faut sortir de l’ombre et imposer sa liberté. La pratiquer. S’organiser entre gens libres. Il faut vouloir être libre, au moins aussi fortement que les intégristes veulent notre soumission. Cela étant, la liberté comme l’honneur sont deux notions qui ont besoin d’être redéfinies dans l’imaginaire et la compréhension de nos compatriotes. Car pour le moment, les deux sont liés sinon au péché, aux crimes et aux abus sur autrui.
Quant à l’exil, on ne part que pour mieux revenir.
Myassa Messaoudi, Honneur à crédit, Algérie, éditions Frantz Fanon, 2025, 1200 DA / 18 €.
